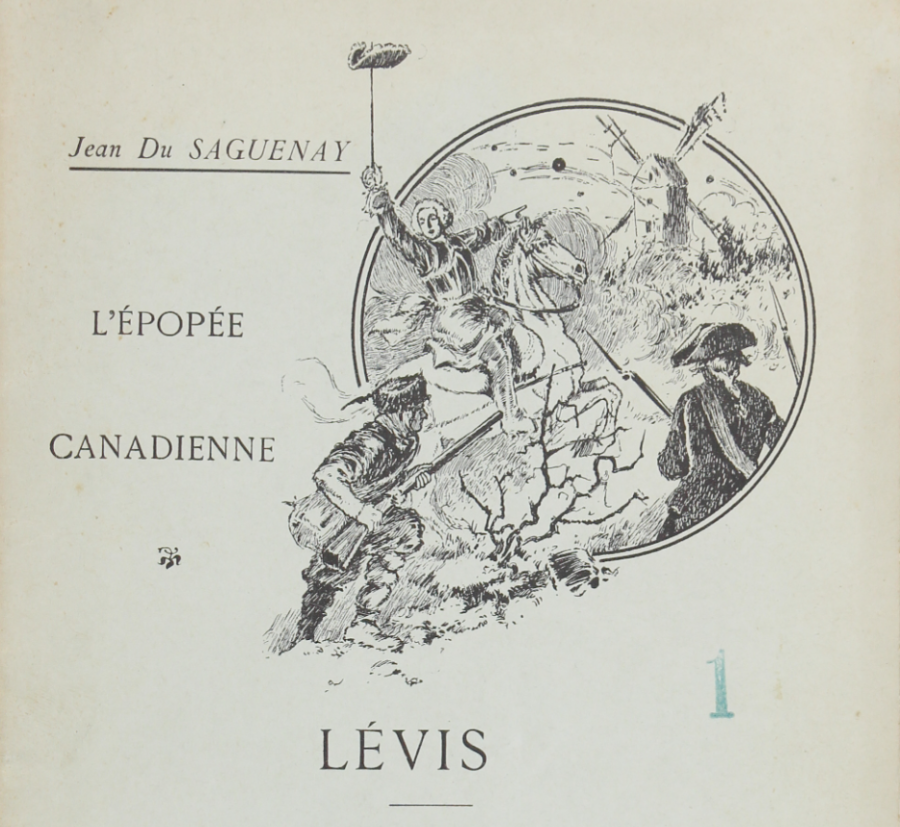De la maison Pinguet au moulin Dumont
Pendant longtemps, toutes les terres se trouvant éloignées de quelques kilomètres des murs de la ville de Québec sont considérées comme la banlieue. C’est le cas de la vaste étendue de terre qu’acquiert le commis de traite Pierre Delaporte en 1639. Il construit un corps de logis qui nous apparaît très petit aujourd’hui, mais assez grand pour y dormir et manger, avec un espace intérieur de moins de 10 m2. En 1646, le marchand Henry Pinguet achète une partie de cette terre, entre la Grande Allée et la rivière Saint-Charles, et agrandit le bâtiment habité pour y inclure deux chambres. Sur une carte datée de 1685, le terrain est indiqué toujours appartenir à la veuve Pinguet.
Quelques décennies plus tard, en 1705, le marchand tanneur Jacques Jahan achète une partie du terrain située au nord de ce qui est aujourd’hui le chemin Sainte-Foy. C’est là qu’il fait construire une tannerie, une maison, et un moulin à vent en bois. Puis en 1741, c’est Jean-Baptiste Dumont, négociant, qui en devient propriétaire. Il remplace en 1747 le moulin en bois par un moulin en pierre. Il s’agit d’un moulin à tan, qui permet de broyer les écorces des arbres dont l’utilisation est nécessaire pour tanner les peaux et les transformer en cuir durable. C’est ce moulin qui joue un rôle crucial à peine plus d’une décennie plus tard, lors de la guerre de la Conquête.
Le moulin Dumont dans la bataille de Sainte-Foy
En 1759, à Québec, on se prépare à la guerre, puis on subit le siège. Après une défaite sur les plaines d’Abraham en septembre, l’armée française passe l’hiver à Montréal. François-Gaston de Lévis, à la tête des troupes depuis la mort du général Montcalm souhaite effectuer une tentative de reprendre la ville de Québec. Pour ce faire, on planifie une attaque hâtive au printemps, qui permettra de surprendre l’ennemi.
À la fin d’avril 1760, les glaces viennent à peine de commencer à céder leur place et permettre la navigation. La neige est encore présente en de nombreux endroits et les terrains sont boueux à cause de la fonte des neiges.
Du côté britannique, on passe l’hiver à l’intérieur des murs de la ville aux côtés de la population locale. L’hiver est dur de part et d’autre ; les réserves de nourriture ne suffisent pas et les soldats anglais souffrent de maladies qui les affaiblissent grandement.
Le général James Murray est responsable des forces britanniques à Québec depuis l’automne précédent. Mis au courant de l’arrivée de l’armée française à Québec, il est prêt le 28 avril 1760. Il fait disposer plus de 20 canons sur les buttes à Nepveu, sur les plaines d’Abraham (près de l’actuel Musée des plaines d’Abraham). Lorsque les premiers soldats français s’approchent pour l’attaque, Murray, conscient de son infériorité numérique, décide d’attaquer avant que les Français ne puissent déplacer toutes leurs troupes et véritablement s’installer en ordre de bataille.
La bataille se déroule encore une fois sur les hauteurs de Québec. Elle a lieu sur une bonne partie de la largeur du promontoire, mais plus à l’ouest que lors de la bataille de septembre 1759. Les affrontements entre les deux armées ont surtout lieu aux alentours de ce qui constitue aujourd’hui l’avenue et le parc des Braves, et qui font partie du parc des Champs-de-Bataille.
- 7 000 hommes avec l’armée française
- 3 400 hommes avec l’armée britannique
Le moulin construit par Jean-Baptiste Dumont, situé sur le site de l’actuel parc des Braves, devient un lieu important de la bataille. Il est positionné à l’emplacement le plus élevé de cette portion de terrain et permet d’avoir un bon point de vue sur le champ de bataille. De plus, le moulin est constitué de solides murs de pierre de près d’un mètre d’épaisseur. Durant la bataille, il devient un endroit stratégique à contrôler et les deux camps essaient d’en garder la maîtrise pour cette raison.
Les combats sont très violents : on combat de manière rapprochée, à la baïonnette. La bataille dure environ trois heures, au terme desquelles le général James Murray sonne la retraite. L’armée britannique se réfugie à l’intérieur des murs de la ville fortifiée. La bataille a causé plusieurs centaines de morts et de blessés des deux côtés, surtout du côté britannique. La bataille de Sainte-Foy est une victoire française, mais elle ne permet pas de reprendre la ville. Les hommes de Lévis préparent donc un siège tout près des fortifications.
Le moulin après la prise de Québec par les Britanniques
Avec la capitaluation de Montréal en septembre 1760, les années suivantes se déroulent sous régime militaire, avant que le territoire qui était autrefois la Nouvelle-France ne devienne officiellement britannique avec la signature du traité de Paris.
Avec cette cession du territoire, plusieurs hauts placés britanniques prennent possession de plusieurs terres. C’est notamment le cas de James Murray, qui acquiert plusieurs seigneuries. En 1774, quelques années après avoir été rappelé en Angleterre, il loue la totalité de ses terres de la province de Québec à un certain Henry Caldwell.
Henry Caldwell est un ancien officier de l’armée britannique, proche de l’état-major. Il a joué un rôle déterminant dans les décisions lors des campagnes de 1759-1760 et lors de l’attaque de Québec par les Américains en 1775. Cela lui permet une certaine aisance financière. L’une des terres qu’il loue de Murray est celle qui se nomme à l’époque le domaine Sans Bruit. Ce domaine est situé tout près du moulin Dumont. Aujourd’hui, la villa Sans-Bruit, sur l’avenue Brown, rappelle ce nom.
Grand propriétaire foncier dans les décennies suivantes, Caldwell possède et offre en location plusieurs parcelles de terre dans la banlieue de Québec, sur la rive sud de Québec et plus à l’ouest. Il est membre du conseil législatif, et a aussi fait fortune grâce à ses nombreux moulins pour le blé et, plus tard, pour scier le bois.
En 1781, Caldwell devient propriétaire du moulin Dumont et des terrains environnants. La bataille de Sainte-Foy avait gravement endommagé le moulin et il décide de ne pas le conserver. Des fouilles archéologiques effectuées en 2010 et 2011 ont permis de dégager les vestiges de maçonnerie de la base du moulin, à l’est de la terrasse du parc des Braves.
En 1854, le terrain près de l’ancien moulin Dumont est racheté par la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec pour ériger un monument dédié aux combattants de la bataille de Sainte-Foy. Ce site fait aujourd’hui partie du parc des Braves, propriété de la Commission des champs de bataille nationaux.
Images :
- Vestiges du Moulin Dumont. 2010
- L'épopée canadienne, Lévis [détail] 1908, Commission des champs de bataille nationaux
- Caron, Gitane. Croquis représentant la bataille de Sainte-Foy [détail] Dessin. 2017, Commission des champs de bataille nationaux